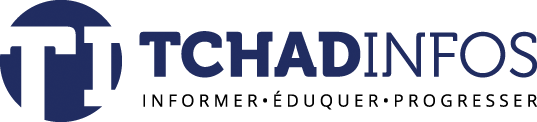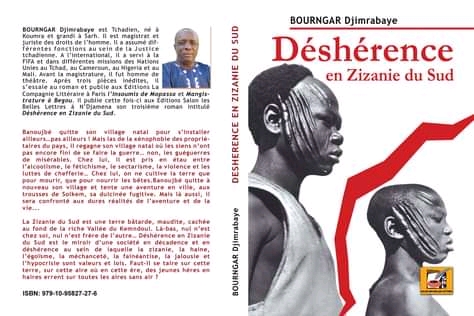LITTERATURE – Inspiré de la Zizanie du Sud, un pays imaginaire, le livre de Bourngar est une parodie de lutte pour le pouvoir. Décryptage.
Du fauteuil présidentiel, au tabouret du chef de village en passant par la chéchia du chef de canton, tout est bon pour le peuple, tout aussi imaginaire, Sara, de se lancer dans une guerre fratricide sans merci, qui profite davantage à leurs ennemis et à leurs élites. L’identité Sara s’effrite. L’on ne découvre que des Gor, des Mbay, des Ngambay, des Sar, des Nar, des Goulay, des Day, etc. Et même des sous-groupes au sein des mêmes groupes à l’exemple des Mbay-Mainsilla fragmentés en Mbay-Bedjou, Mbay-Kan, Mbay-Ngoka, etc.
Aucune province de la Zizanie du Sud ne sera donc épargnée. Outré, Banoujbé dont le nom signifie littéralement «la-haine-détruit-le-pays» quitte Koumra pour son Peni natal. Mais là aussi, il apprendra que les décors ont changé mais pas la réalité qui demeure des plus tenaces. En dehors du marché de Mardi consacré au dieu Bacchus où coule l’alcool à flot et les hommes, qui boivent jusqu’à la dernière goutte de la raison, s’adonnent à tous les excès et se laissent tentés par tous les démons. Ceux qui se disent «frères en Christ» sont foncièrement divisés, manipulés par les autorités et les grands-frères de Polomy, la capitale de la Zizanie du Sud.
Vivant au seuil du minimum vital, les Pen privilégient les valeurs éphémères en lieu et place des vraies valeurs humaines. En total écart, les Pen sont parfois rappelés à l’ordre par les gens dont leur stigmatisation jugée peu recommandable. A l’exemple de ce colombien, comme la plupart des jeunes qui échouent au marché de Dembé qui usent de filouterie pour survivre, contrairement à ces frères censés «réussir» leur vie. Blasco prononça un discours émouvant lors des funérailles de Tante Ngodjo et lui fait des hommages mérités.
Incapables de faire front, les Sara, à l’exemple de ceux de Peni, sont victimes du sempiternel conflit entre agriculteurs et éleveurs. Pour ainsi dire, l’auteur insinue que les vrais ennemis des Pen sont les Pen. Car il arrive des fois où, comme il en est le cas dans son livre, que Aba Afkar, le chef d’un ferrick se ligue avec les agriculteurs contre ses frères éleveurs au péril de sa vie, celle de sa famille et de sa communauté, pendant que le Sultan Noujngué, chef de la communauté Pen, et ses ouailles jouent à la désinvolture.
Le comble est le combat pour la chefferie qui oppose Banoujbé à son « frère » Mangarto, un ennemi qui se montrera redoutable, au village Beko. Car si à Peni ou à Beko, le mot cousin est remplacé par frère, il reste néanmoins qu’un adversaire politique est un ennemi à abattre, parce que le combat pour la chefferie ici est justement un combat à mort.
Hélas, Banoujbé, qui vient de perdre du coup son meilleur ami ainsi que sa première épouse dans des conditions atroces et la seconde qui l’a quitté pour Polomy dans les bras d’un cousin rival, n’a pas le courage de poursuivre ce combat et se frotter aux mentors citadins de son rebelle de cousin et surtout à Sultan Noujngué, déterminé à voir son poulain accéder au trône, « par force ou par fraude » ou à diviser ce village Beko en deux.
Excédé par moult tentatives du camp ennemi qui pousse le ridicule à son comble, après s’être constitué en devers des conseils des fidèles amis, pour éviter le pire à son terroir, Banoujbé jette l’éponge et se paye une aventure à Polomy (dont les villageois vantent tant les merveilles) à la recherche de son bonheur avec à la clé l’espoir de retrouver son amour perdu. Mais Polomy, c’est tout un monde à part qui se déroulera à son regard. Un monde impitoyable où l’instinct de survie oblige l’homme à se dépouiller de toute son humanité et de tout humanisme. L’individualisme peut donc amener un homme à renier son origine et même ses frères de sang. La solidarité légendaire a donc foutu le camp. A Polomy, on mange son totem.
Son apprentissage commence dès Peni où deux jeunes paysannes, habituées de Polomy, lui adressent la parole, à lui le chef Banoujbé, comme un vulgaire quidam. Puis les quatre jours passés à même le sol et à faire les poubelles autour du marché de Dembé pour survivre le confortent dans cette idée, après être grugé par un voyageur véreux et des colombiens à peine sorti de la gare. Le comble est cependant le comportement de la femme de son cousin fonctionnaire, censée l’accueillir avec faste. Pourtant la dernière ne lui témoigne aucune considération et lui assigne d’humiliantes corvées.
Pour pouvoir vivre avec le minimum de dignité dans cet environnement hostile où «chacun pour soi, Dieu pour tous!», Banoujbé décide donc de travailler comme domestique chez la quatrième épouse d’un colonel. Question de subir des humiliations à huis-clos jusqu’à appeler la bonne dame, moins âgée que sa deuxième épouse, de maman, « Iya », pour survivre. La cerise sur le gâteau, il doit renoncer à son identité et porter, comme il est de coutume chez les boydoum, un pseudonyme. Il choisit Paul. Il s’appellera désormais Paul. Bien que jouant le domestique en temps plein et le substitut du colonel en son absence, permettant de chauffer les draps de la bonne dame, cela permettait à Paul de retrouver sa noblesse de Ngar, le chef, perdu en milieu des « fonctionnaires de la rue de 40 ». Mais ce train de vie, sans sa dulcinée, le dégoutait autant que les traitements inhumains qu’il n’arrêtait d’essuyer…
Banoujbé tombe sous le coup fatal du couteau de son jaloux cousin Bandoumal pour qui sa femme Solkem avait quitté Peni. Bandoumal s’avère être un fidèle lieutenant de Mangarto avec qui ils croisaient le fer pour la chefferie. Mangarto ne survivra pas non plus à cette haine fratricide. Il est retrouvé sans vie à Beko. D’autres jeunes de Beko sont morts dans cette furie. Ce qui fait chanter à Nguewel la cantatrice que Beko est mort ! Certainement du fait que ses enfants ne se considèrent plus comme des frères !
Comme d’habitude, Djimrabaye BOURNGAR nous plonge, à travers ce livre dans une réalité qui ressemble fort bien à celle dont nous vivons dans nos sociétés. Là où, au nom de la modernité, ces citadins, ces civilisés et ces évolués nous conduisent dans l’impasse. L’acculturation est à son comble et tant que nous ne renouons pas « le bois au bois », nos pays sont appelés à mourir, comme Béko ! Voilà tout l’appel de Djimrabaye BOURNGAR.