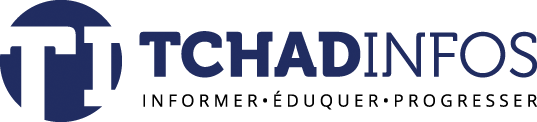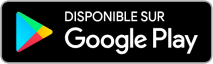À l’issue de sa session annuelle tenue à Paris, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a inscrit 26 nouveaux sites culturels et naturels sur la Liste du patrimoine mondial. Une avancée majeure, notamment pour le continent africain.
Réunis dans la capitale française, les membres du Comité ont validé l’ajout de 26 biens, ainsi que l’extension de deux sites déjà inscrits. Le patrimoine mondial compte désormais 1 248 sites répartis dans 170 pays.
« Avec 196 États parties, la Convention du patrimoine mondial est l’une des plus universellement ratifiées au monde, preuve de son rayonnement et de sa popularité aux quatre coins du globe », a déclaré la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. Elle a rappelé que cette reconnaissance s’accompagne d’une responsabilité majeure : préserver, transmettre et valoriser un héritage d’une valeur universelle exceptionnelle.
Parmi les nouveaux inscrits figurent des paysages spectaculaires, des vestiges de civilisations anciennes et des lieux de mémoire chargés d’émotion.
L’Afrique à l’avant-plan
Le continent africain a occupé une place centrale lors de cette session, avec l’inscription de quatre nouveaux sites. Depuis 2020, l’UNESCO indique avoir mobilisé plus de 34 millions de dollars pour la préservation du patrimoine africain.
« Faire de l’Afrique une priorité n’est pas un geste symbolique. C’est un engagement concret, quotidien et inscrit dans la durée », a insisté Mme Azoulay. Elle a précisé qu’en six ans, 19 nouveaux sites africains ont été inscrits sur la liste, et six autres retirés de la liste du patrimoine en péril.
Fait marquant de cette édition : la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont présenté pour la première fois une candidature. Sept autres pays africains sont attendus d’ici 2027.
L’une des inscriptions phares concerne l’extension d’un site sud-africain vers le Mozambique, créant ainsi un vaste parc naturel transfrontalier de 4 000 km². Ce projet illustre l’importance croissante accordée à la coopération régionale pour la protection des écosystèmes.
Vers un patrimoine vivant et inclusif
Cette session a également été marquée par une reconnaissance accrue du rôle des communautés locales dans la préservation de leur patrimoine. Plusieurs candidatures ont été portées directement par les populations concernées, avec l’appui des autorités nationales comme ce fut le cas pour certains sites africains ou encore pour le paysage culturel aborigène de Murujuga, en Australie.
Ces approches soulignent une évolution majeure dans la vision du patrimoine : il ne s’agit plus seulement de monuments figés, mais de cultures vivantes, nourries par des pratiques sociales, spirituelles et ancestrales, souvent situées dans des territoires vulnérables.